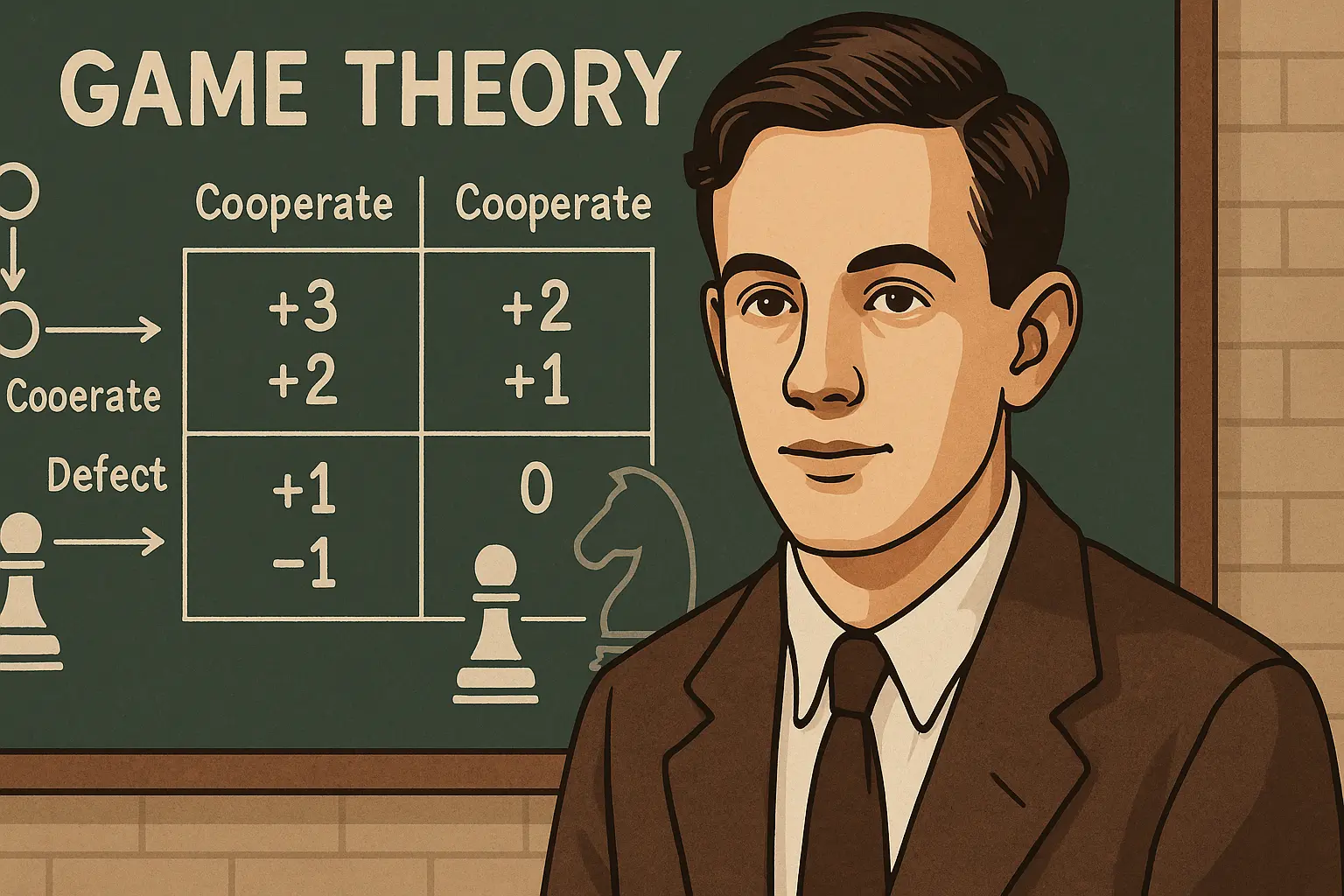1 — Une vie hors norme : mathématicien, chercheur et
esprit brillant
Né en 1928 dans une petite ville américaine, Nash grandit
loin des grands centres scientifiques mais montre très tôt un talent
exceptionnel pour les mathématiques. Enfant solitaire, passionné par les
puzzles et les problèmes logiques, il développe une manière très personnelle de
réfléchir : rigoureuse, indépendante, souvent déroutante pour les enseignants.
Cette singularité devient sa plus grande force.
À seulement 21 ans, il intègre l’université de Princeton,
l’un des plus grands foyers intellectuels du monde. C’est là qu’il rédige une
thèse très courte — quelques pages seulement — mais révolutionnaire : une
nouvelle façon de comprendre les décisions rationnelles lorsque plusieurs
acteurs sont en interaction. Cette idée deviendra la théorie des jeux
moderne, un outil qui influencera l’économie, la géopolitique, la biologie,
l’informatique, et plus tard, l’analyse des marchés financiers.
Le parcours de ce chercheur est aussi marqué par une épreuve
personnelle majeure : une longue lutte contre la schizophrénie, qui met sa
carrière en pause pendant des années. Malgré cela, son génie demeure intact. Il
revient progressivement à la recherche dans les années 1980, retrouve sa
lucidité, et reçoit en 1994 le prix Nobel d’économie pour son travail
fondateur.
Ce qui frappe chez lui, c’est l’alliance entre abstraction
mathématique et compréhension très fine des comportements humains. Sa manière
d’aborder les interactions stratégiques a transformé la façon dont on étudie la
concurrence, la coopération et les conflits. On lui doit une idée centrale de
l’économie moderne : les situations où chacun fait le meilleur choix possible compte
tenu du choix des autres, mais où le résultat collectif est parfois
sous-optimal.
Aujourd’hui, sa pensée irrigue autant le programme de
Terminale que la recherche internationale. Comprendre ses travaux, c’est
comprendre comment se prennent réellement les décisions dans un monde où
personne n’agit seul.
2 — Ce qu’est la théorie des jeux : interactions
stratégiques et rationalité
La théorie des jeux part d’une idée simple : dans de
nombreuses situations économiques ou sociales, le résultat ne dépend pas
seulement de ce que je fais, mais aussi de ce que les autres
décident de faire. On n’agit jamais dans le vide : on choisit en anticipant les
choix des autres, qui eux-mêmes anticipent les nôtres. C’est cette logique
d’interdépendance qui définit une interaction stratégique.
Dans ce cadre, un “jeu” n’a rien de ludique. C’est une
situation où plusieurs acteurs — individus, entreprises, États, électeurs —
prennent des décisions qui influencent leurs résultats mutuels. Une négociation
salariale, une guerre commerciale, une stratégie marketing, une entente entre
firmes ou même un choix de stationnement relèvent tous de cette logique.
Chaque acteur dispose d’une stratégie, c’est-à-dire
d’un plan d’action possible. À chaque stratégie correspond un gain (ou
un coût), qui dépend non seulement de son propre choix mais aussi de celui des
autres participants. La rationalité, dans ce cadre, consiste à choisir la
stratégie qui maximise son intérêt en tenant compte des réactions
possibles ou probables des autres.
Cette approche change profondément la manière d’analyser le
comportement humain. Elle ne se contente pas d’observer un individu isolé
optimisant son intérêt, mais elle intègre le fait que chacun devine, surveille,
calcule, imite ou anticipe les comportements d’autrui. C’est un modèle
dynamique : une stratégie peut être bonne dans un contexte et catastrophique
dans un autre, selon les intentions et les moyens des joueurs en présence.
La théorie des jeux permet donc de comprendre pourquoi la
coopération se produit parfois, et pourquoi elle échoue dans d’autres cas. Elle
rend visible la manière dont les décisions individuelles peuvent converger vers
un résultat collectif cohérent… ou au contraire produire un équilibre mauvais
pour tout le monde. C’est un outil puissant pour analyser la compétition, la
coordination et les conflits, qu’ils soient économiques, politiques ou sociaux.
3 — Le fameux “équilibre de Nash” : quand personne n’a
intérêt à changer seul
L’idée centrale de la théorie des jeux tient dans un concept
simple et puissant : l’équilibre de Nash. Il décrit une situation où
chaque acteur a choisi la meilleure stratégie possible compte tenu des
choix des autres. Personne n’a intérêt à changer seul, car toute modification
unilatérale lui ferait perdre davantage qu’elle ne lui ferait gagner.
Autrement dit : chacun est “bloqué” dans son meilleur choix relatif,
pas nécessairement dans le meilleur choix absolu.
C’est une situation stable… mais pas toujours optimale. C’est même là toute la
subtilité.
Cet équilibre explique de nombreuses situations de la vie
économique et sociale. Deux entreprises qui maintiennent un prix élevé par
prudence. Des États qui restent dans une course à l’armement. Des conducteurs
qui prennent tous la même route pourtant saturée. Des individus qui continuent
une stratégie médiocre simplement parce qu’ils anticipent que les autres ne
bougeront pas non plus.
L’équilibre de Nash n’indique donc pas ce que les acteurs devraient
faire, mais ce qu’ils feront dans un contexte donné, s’ils sont
rationnels et conscients des stratégies des autres. C’est un modèle de
stabilité, mais aussi un révélateur des blocages collectifs : le fait que
chacun optimise pour soi peut aboutir à une situation où personne n’est vraiment
gagnant.
Ce concept montre à quel point la prise de décision dépend
du comportement d’autrui. On ne maximise pas son intérêt seul : on le maximise
face à des adversaires, des alliés, des concurrents ou des partenaires qui
réfléchissent eux-mêmes à maximiser le leur. C’est cette interdépendance qui
rend les décisions stratégiques parfois contre-intuitives.
Comprendre l’équilibre de Nash, c’est comprendre pourquoi
certaines situations semblent figées, pourquoi les acteurs n’abandonnent pas
des stratégies pourtant médiocres, et pourquoi la coordination collective est
si difficile. C’est un outil essentiel pour analyser les marchés, la
concurrence, la politique, mais aussi le comportement humain au quotidien.
Le dilemme du prisonnier est l’exemple le plus célèbre de la
théorie des jeux, parce qu’il met en lumière un paradoxe simple : deux
individus rationnels peuvent prendre chacun la “meilleure” décision pour eux…
mais échouer collectivement.
Le scénario est connu : deux suspects sont interrogés
séparément. Ils ont chacun deux choix : coopérer (se taire) ou trahir
(dénoncer l’autre). Le problème ?
La trahison rapporte toujours un avantage individuel immédiat, quelle que soit
la décision de l’autre. C’est donc, en apparence, la stratégie la plus “sûre”.
Sauf que si les deux adoptent cette logique, ils se
retrouvent tous les deux dans la pire issue possible. C’est là que le dilemme
devient intéressant : la rationalité individuelle conduit à un résultat
irrationnel collectivement.
Ce jeu explique pourquoi certaines coopérations échouent
même quand elles seraient bénéfiques. On le retrouve partout :
-
entreprises tentées de casser les prix alors que
l’entente serait plus rentable,
-
pays qui polluent parce qu’ils craignent que les
autres ne fassent pas d’effort,
-
salariés et employeurs méfiants dans les
négociations,
-
consommateurs qui adoptent des comportements
sous-optimaux par peur d’être les seuls à coopérer.
Le dilemme du prisonnier montre que ce n’est pas la
“méchanceté” ou l’égoïsme qui bloque la coopération, mais la structure de la
situation.
Si je ne suis pas sûr que tu coopères, je protège mes intérêts — et tu fais la
même chose.
Dans ce jeu, l’issue stable est la trahison mutuelle :
personne ne veut coopérer seul.
C’est un équilibre de Nash… mais c’est aussi un piège, car tout le monde
perd par manque de coordination.
Cette idée est centrale : elle révèle que l’intérêt
général n’émerge pas spontanément. Il faut des règles, des accords, de la
confiance ou des mécanismes répétés pour dépasser ce blocage.
5 — Jeux répétés, confiance et comportements réels
Le dilemme du prisonnier montre que la coopération est
difficile lorsqu’on ne joue qu’une seule fois. Mais la réalité n’est pas un
“one shot” : les acteurs économiques, politiques ou sociaux interagissent de
manière répétée, parfois pendant des années. Et c’est précisément là que
tout change.
Dans un jeu répété, chaque décision influence la suivante.
On ne cherche plus uniquement le gain immédiat : on pense à la réaction future
des autres. Trahir peut rapporter une fois, mais peut briser une relation,
déclencher des représailles, fermer des opportunités. Autrement dit : la
réputation entre dans le jeu. Dès qu’un acteur sait qu’il retrouvera
l’autre demain, la coopération devient une stratégie rationnelle.
C’est ce principe que l’on observe dans les relations
commerciales, les négociations salariales, les alliances politiques, les
discussions diplomatiques ou les accords écologiques. Une trahison ponctuelle
peut coûter beaucoup plus cher que le gain immédiat qu’elle permet.
Dans les jeux répétés, des stratégies coopératives peuvent
émerger naturellement. L’une des plus connues est la stratégie “œil pour œil”
(tit for tat) : coopérer tant que l’autre coopère, et répliquer immédiatement
en cas de trahison. Ce comportement simple suffit à créer une certaine
stabilité, parce qu’il est prévisible et facile à comprendre : il récompense la
coopération, punit la trahison, et permet de repartir sur de bonnes bases.
Les jeux répétés montrent que la confiance n’est pas un
sentiment naïf, mais un mécanisme stratégique.
Elle se construit à partir de trois éléments :
-
la mémoire des comportements passés,
-
la possibilité de réagir à une action future,
-
l’attente que l’interaction se poursuive.
Lorsque ces conditions sont réunies, la coopération devient
rationnelle, durable et plus avantageuse que la trahison permanente. On se
rapproche alors d’un équilibre où chacun y gagne davantage que dans le scénario
“tout le monde se protège”.
Ces modèles éclairent avec force l’économie réelle :
pourquoi les entreprises évitent parfois les guerres de prix, pourquoi certains
pays signent des accords difficiles, pourquoi des partenaires commerciaux
entretiennent des liens de long terme, ou encore pourquoi les conflits peuvent
se résoudre après des cycles de représailles. Ils montrent que la rationalité
n’est pas seulement individuelle : elle peut devenir relationnelle.
6 — Apports pour comprendre l’économie moderne
La théorie des jeux a profondément renouvelé l’analyse
économique. Elle permet de comprendre non seulement ce que les acteurs
font, mais pourquoi ils le font, en tenant compte des anticipations, de
la rivalité et de la coopération. Dans une économie où personne n’agit
isolément, ces outils deviennent essentiels.
Le premier apport concerne la concurrence imparfaite.
Sur un marché où quelques entreprises s’observent mutuellement, la décision de
fixer un prix, d’innover, d’entrer sur un marché ou de lancer une promotion
dépend de la réaction attendue des concurrents. Une firme n’abaisse pas
seulement son prix pour attirer les clients : elle le fait aussi pour éviter
qu’un rival ne le fasse en premier. Dans ce cadre, un équilibre de Nash peut
expliquer pourquoi certaines industries stabilisent leurs prix… même si ce
n’est pas l’optimum collectif.
La théorie des jeux éclaire également les situations de coopération
ou d’“entente tacite”. Sans jamais signer un accord illégal, deux entreprises
peuvent éviter une guerre de prix simplement parce qu’elles savent qu’elles se
retrouveront sur le marché demain. Le jeu répété rend la stabilité rationnelle
— et parfois coûteuse pour le consommateur.
Autre apport clé : la négociation. Qu’il s’agisse de
salaires, de contrats, de fusion-acquisition ou de traités internationaux,
chaque acteur calcule non seulement son intérêt, mais aussi la perception, les
menaces crédibles et le rapport de force. La théorie des jeux explique pourquoi
certains compromis émergent, pourquoi d’autres échouent, et comment les
positions se durcissent ou se relâchent.
Elle aide aussi à comprendre les situations de
coordination : choisir une norme technologique, décider d’une monnaie
commune, harmoniser des règles environnementales… Ces décisions nécessitent que
tous fassent le même choix simultanément. Ici encore, l’équilibre de Nash
permet de comprendre pourquoi certaines normes s’imposent, même lorsqu’elles ne
sont pas les plus efficaces.
L’approche éclaire enfin les conflits d’intérêt et
les problèmes d’action collective : pollution, surexploitation des ressources,
fraude, financement de biens publics. Chacun aurait intérêt à suivre l’intérêt
général… mais seulement si les autres le font aussi. Le dilemme du prisonnier
fournit alors un modèle puissant pour analyser ces blocages.
Au total, la théorie des jeux offre une lecture plus
réaliste et plus fine de l’économie moderne. Elle montre que les marchés ne
sont pas des mécanismes automatiques, mais des espaces où des acteurs
stratégiques se surveillent, s’imitent, se défient et parfois coopèrent. C’est
une manière de comprendre que l’économie n’est jamais un calcul isolé : elle
est faite d’interactions.
7 — Limites de la théorie des jeux : rationalité
imparfaite et comportements humains
Aussi puissante soit-elle, la théorie des jeux repose sur
une hypothèse forte : les acteurs seraient parfaitement rationnels, capables
d’anticiper, de calculer et d’interpréter toutes les stratégies possibles. Dans
la réalité, cette hypothèse s’effrite vite. Les humains ne sont ni des
machines, ni des calculateurs infaillibles.
La première limite concerne justement cette rationalité
imparfaite. Les individus prennent souvent des décisions influencées par
les émotions, les biais cognitifs, la pression sociale ou le manque
d’information. La peur, la confiance excessive, le conformisme ou l’aversion au
risque modifient profondément les choix stratégiques. Ce décalage explique
pourquoi certains jeux théoriquement simples produisent, en pratique, des
comportements inattendus.
L’autre limite tient au fait que les acteurs ne disposent jamais
d’une information parfaite. Dans la plupart des situations, on ne sait pas
exactement ce que l’autre pense, ce qu’il veut, ce qu’il sait ou ce qu’il peut
faire. Les “jeux à information incomplète” — très réalistes — sont bien plus
complexes que les modèles de base, et peuvent donner lieu à des erreurs de
calcul ou à des anticipations fausses.
De plus, la théorie des jeux suppose souvent que les acteurs
comprennent la structure du jeu. Or, dans la vie réelle, les individus ne
perçoivent pas toujours la situation comme un dilemme du prisonnier, un jeu de
coordination ou un jeu répété. Ils peuvent réagir selon des représentations
erronées, des habitudes culturelles ou des intuitions personnelles, ce qui les
éloigne des prédictions théoriques.
Autre limite : le poids de la confiance et des normes
sociales. Beaucoup de coopérations durables ne s’expliquent pas par un
calcul froid, mais par l’existence de normes, de valeurs partagées ou d’un
sentiment d’appartenance. Dans certains contextes, les acteurs coopèrent même
lorsqu’il serait rationnel de trahir. Cela montre que le cadre théorique capte
une partie du réel, mais pas toute sa complexité morale et culturelle.
Enfin, la théorie des jeux décrit souvent des équilibres
stables, mais le monde réel est fait de changements rapides : nouvelles
technologies, chocs économiques, crises politiques, transformations sociales.
Les comportements évoluent plus vite que les modèles. Les équilibres se
déplacent, se brisent, se recomposent.
Ces limites ne rendent pas la théorie des jeux inutile, bien
au contraire : elles rappellent qu’elle est un outil, pas une vérité
totale. Elle éclaire les mécanismes de base des interactions stratégiques, mais
doit être complétée par la psychologie, la sociologie et l’observation concrète
des comportements humains.
8 — Pourquoi la théorie des jeux reste essentielle
aujourd’hui
La force de la théorie des jeux, c’est qu’elle continue
d’expliquer des situations que l’on observe chaque jour. Dans un monde où les
acteurs — individus, entreprises, États — sont de plus en plus interdépendants,
comprendre les interactions stratégiques devient indispensable. La théorie des
jeux fournit justement cette grille de lecture simple, mais incroyablement
puissante.
Dans l’économie contemporaine, la concurrence n’est presque
jamais “parfaite”. Les entreprises s’espionnent, s’imitent, réagissent en
fonction des anticipations. La théorie des jeux éclaire ces comportements mieux
que n’importe quel autre outil. Elle aide à comprendre pourquoi certaines
industries se stabilisent, pourquoi les guerres de prix éclatent, pourquoi la
coopération peut émerger… ou exploser.
Dans la politique et la géopolitique, elle permet d’analyser
la prise de décision dans les conflits, les négociations internationales, la
dissuasion nucléaire ou les alliances stratégiques. Le principe de “je fais le
meilleur choix compte tenu de ton choix” est au cœur des relations entre
grandes puissances.
Dans les relations sociales, le concept est tout aussi
pertinent : voter, se mobiliser, respecter une règle, coopérer dans un groupe,
partager une ressource… ce sont toujours des décisions qui dépendent du
comportement des autres. Les jeux répétés permettent d’expliquer pourquoi la
confiance peut émerger, et pourquoi elle disparaît parfois brutalement.
Même le numérique repose en partie sur ces logiques :
réseaux sociaux, plateformes, algorithmes de recommandation ou stratégies des
grandes entreprises tech sont structurés par des interactions stratégiques
permanentes. La théorie des jeux permet alors de comprendre pourquoi certains
équilibres se forment — et pourquoi d’autres s’effondrent.
Si elle reste essentielle aujourd’hui, c’est donc parce
qu’elle offre un cadre pour penser la complexité, anticiper les
comportements, comprendre les blocages et identifier les solutions. Elle ne
donne pas toutes les réponses, mais elle met au jour les mécanismes invisibles
derrière la coopération, le conflit, la coordination et la concurrence.
Dans un monde où l’on agit rarement seul, la théorie des
jeux n’a jamais été aussi moderne.