Détails du terme - La Concurrence Pure et Parfaite
La Concurrence Pure et Parfaite
📘 La Concurrence Pure et
Parfaite (CPP)
🧠 Définition générale
La concurrence pure et parfaite est un modèle théorique
qui permet aux économistes de comprendre le fonctionnement d’un marché où
aucune entreprise ni aucun consommateur ne peut influencer seul le prix. Dans
ce système, le prix du marché s’impose à tous, sans pouvoir de
négociation. Ce modèle repose sur des conditions précises qui, une fois
réunies, assurent une forme idéale de régulation par l’offre et la demande.
⚙️ Les cinq conditions du modèle
Ce modèle est dit "pur et parfait" car il repose
sur cinq conditions qui doivent être simultanément réunies. Voici
leur signification :
|
Condition |
Explication |
|
Atomicité du marché |
Le marché doit être composé d’un très grand nombre
d’acheteurs et de vendeurs. Ainsi, aucun acteur ne peut influencer seul
le prix du marché. |
|
Homogénéité des produits |
Les produits proposés par les vendeurs doivent être strictement
identiques : même qualité, même usage, aucun moyen de les différencier. |
|
Libre entrée et sortie |
Toute entreprise peut entrer ou sortir librement du
marché, sans barrière administrative, juridique, technologique ou
financière. |
|
Transparence de l’information |
Tous les participants disposent d’une information
parfaite et gratuite sur la qualité des produits, les prix pratiqués, les
quantités disponibles… |
|
Mobilité des facteurs |
Le capital (machines, argent) et le travail
(salariés) peuvent se déplacer librement d’un secteur ou d’une
entreprise à une autre. |
Lorsque ces cinq conditions sont réunies, on dit que le
marché est en concurrence pure et parfaite.
🎯 Résultats attendus dans
ce modèle
Lorsqu’un marché fonctionne selon le modèle de la
concurrence pure et parfaite, le prix se fixe naturellement par le jeu
de l’offre et de la demande. Les producteurs n’ont pas de pouvoir de marché :
ils doivent accepter le prix du marché. Ce sont des "preneurs de
prix", ce qu’on appelle en économie des price takers.
L’allocation des ressources est alors considérée comme optimale
: les entreprises produisent les biens que les consommateurs souhaitent
acheter, en quantité adaptée. Cela permet d’éviter les gaspillages, les
pénuries ou les excès de production.
🧪 Exemple concret
Dans un petit village, tous les agriculteurs viennent au
marché vendre exactement les mêmes pommes. Les habitants connaissent les
prix de chaque vendeur et peuvent comparer facilement. Si un producteur
vend plus cher, les clients iront voir ailleurs. De nouveaux vendeurs peuvent
aussi venir vendre leurs pommes sans obstacle. Dans ce cas, aucun vendeur ne
peut imposer son prix, et tous s’alignent naturellement sur le prix
d’équilibre du marché.
⚠️ Limites du modèle dans la
réalité
Le modèle de la concurrence pure et parfaite est une fiction
utile : il aide à comprendre les mécanismes économiques, mais n’existe pas
réellement dans le monde d’aujourd’hui. De nombreuses limites apparaissent
lorsqu’on le confronte à la réalité :
|
Limite |
Explication |
|
Différenciation des produits |
Les entreprises cherchent souvent à se distinguer
en jouant sur la qualité, la marque, l’image ou le service après-vente. |
|
Barrières à l’entrée |
Il existe fréquemment des obstacles juridiques ou
financiers qui empêchent certaines entreprises d’entrer facilement sur un
marché. |
|
Information imparfaite |
Les consommateurs n’ont pas toujours accès à toutes les
informations nécessaires (prix, qualité réelle, origine…). |
|
Pouvoir de marché |
Certaines entreprises, très puissantes, peuvent influencer
le prix (on parle alors de monopole ou d’oligopole). |
📚 Intérêt du modèle pour
les économistes
Même s’il est théorique, ce modèle reste fondamental
pour les économistes car il sert de référence idéale. Il permet de
comparer les marchés réels à ce modèle de fonctionnement parfait. Plus un
marché s’en rapproche, plus il est considéré comme efficace. En cas
d’écarts importants, cela peut justifier une intervention de l’État pour
rétablir un fonctionnement plus juste ou plus concurrentiel (par exemple, en
imposant la transparence des prix ou en luttant contre les abus de position
dominante).
✅ À retenir
La concurrence pure et parfaite est un modèle économique
théorique dans lequel le prix résulte uniquement de la confrontation de l’offre
et de la demande. Elle repose sur cinq conditions : atomicité, homogénéité des
produits, libre entrée et sortie, transparence de l’information et mobilité des
facteurs. Ce modèle permet une allocation optimale des ressources, mais il
reste très éloigné de la réalité. Il constitue néanmoins un repère central pour
analyser les marchés et leurs imperfections.
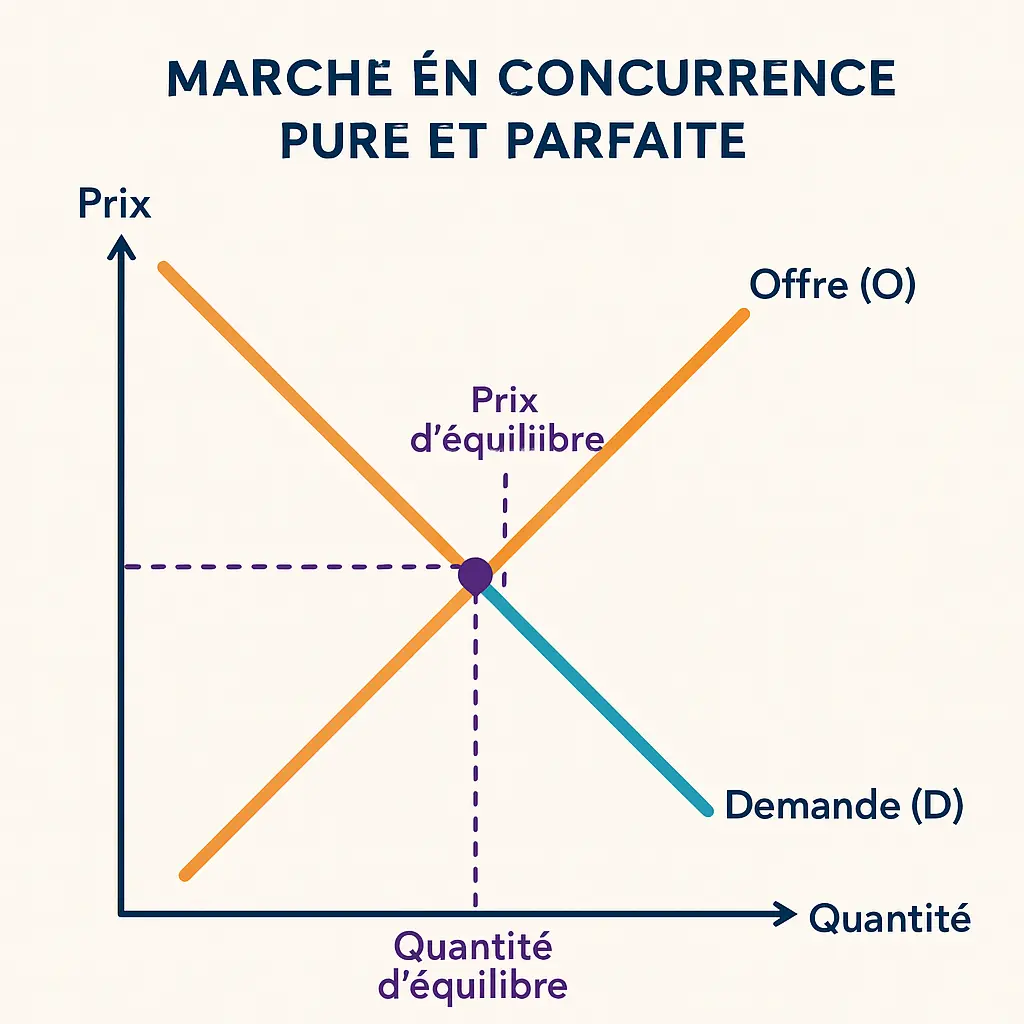
🖼️ Légende et lecture du
schéma
📌 Légende des éléments du
graphique
|
Élément du graphique |
Signification dans le modèle économique |
|
Axe vertical (Prix) |
Représente le prix d’un bien ou service sur le
marché |
|
Axe horizontal (Quantité) |
Représente la quantité de biens échangés sur le
marché |
|
Courbe d’offre (O) |
Montre que plus le prix est élevé, plus les producteurs
sont prêts à vendre |
|
Courbe de demande (D) |
Montre que plus le prix est élevé, moins les consommateurs
sont prêts à acheter |
|
Point d’intersection |
C’est le point d’équilibre : il indique le prix
d’équilibre et la quantité échangée optimale |
|
Lignes pointillées |
Permettent de lire directement les valeurs de prix et de
quantité d’équilibre sur les axes |
🧠 Explication dans le
contexte de la concurrence pure et parfaite
Ce graphique illustre le fonctionnement automatique
du marché dans un contexte de concurrence pure et parfaite.
Dans ce modèle :
- Les
entreprises n'ont aucun pouvoir pour fixer les prix. Elles doivent accepter
le prix du marché (price takers).
- Les
consommateurs sont parfaitement informés, donc ils choisissent toujours l’offre
la plus avantageuse.
- Les
deux courbes se croisent au point d’équilibre. C’est là que l’offre
égale la demande.
- Ce
prix est le seul où il n’y a ni surplus (trop de biens invendus),
ni pénurie (demande non satisfaite).
C’est donc un système autorégulé, sans intervention
extérieure, qui assure une allocation optimale des ressources dans la
théorie.